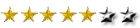Avez-vous aimé ce livre?
 LA CHORALE DES MAITRES BOUCHERS de Louise Erdrich
LA CHORALE DES MAITRES BOUCHERS de Louise Erdrich
Ven 10 Fév 2012 - 22:47

Résumé
1918. De retour du front, Fidelis Waldvogel, un jeune soldat allemand, tente sa chance en Amérique. Avec pour seul bagage une valise pleine de couteaux et de saucisses, il s’arrête à Argus, dans le Dakota du Nord où, bientôt rejoint par sa femme et son fils, il décide d’ouvrir une boucherie et de fonder une chorale, en souvenir de celle des maîtres bouchers où chantait son père. Des années 1920 aux années 1950, entre l’Europe et l’Amérique, ce roman à la fois épique et intime retrace le destin d’une famille confrontée au tumulte du monde.
Date de parution : 16/05/2007
Edition: le livre de poche
Collection : Littérature & Documents
Prix TTC :7,50 €
Edition: le livre de poche
Collection : Littérature & Documents
Prix TTC :7,50 €
 Re: LA CHORALE DES MAITRES BOUCHERS de Louise Erdrich
Re: LA CHORALE DES MAITRES BOUCHERS de Louise Erdrich
Ven 10 Fév 2012 - 23:04
Merci d'avoir créé cette fiche !
Mon avis :
La Chorale des maîtres bouchers est le roman d’une rencontre. Une rencontre aux visages multiples, infidèle et aussi légère que le vent, semblable à la chance, tant elle voltige – acrobate virtuose – d’un personnage à un autre.
« Fidelis rentra chez lui à pied en douze jours de la Grande Guerre, et dormir trente-huit heures dès qu’il se fut glissé dans son lit d’enfant. Quand il s’éveilla en Allemagne, fin novembre 1918, il n’était qu’à quelques centimètres de devenir français sur la carte redessinée par Clémenceau et Wilson, un fait sans importance au regard de ce que l’on pourrait manger. »
Les premières pages du roman plonge le lecteur au cœur de l’après-guerre, au côté de Fidelis, jeune soldat allemand et rescapé du fléau 14-18. Deux pages tournées, et déjà il rencontre Eva. Fiancée de son meilleur ami et victime involontaire de la Grande Guerre, Eva devient – en quelques mots prononcés - une jeune veuve au regard douloureux. Grandeur de l’amitié, amour de son prochain : un mariage succède rapidement à leur rencontre, Fidelis épousant à la fois la femme et l’enfant qu’elle porte.
« Il acquit la conviction qu’il devrait partir en Amérique parce qu’il vit, de ce pays-là, une tranche de pain. […] Cet homme tenait à la main quelque chose de blanc et de carré, que Fidelis prit d’abord pour une sorte d’image, mais elle était vierge. Quand il comprit que c’était du pain, modelé avec une précision qui ne pouvait être que l’œuvre de fanatiques, il se joignit au cercle des hommes pour l’examiner. […] Quand, passé de main en main, il parvint jusqu’à lui, Fidelis inspecta le pain. Il en nota la fine texture et s’interrogea sur le traitement de la levure, observa le bord bien taillé de la coupe, hocha la tête devant le brun doré étrangement uniforme de la croûte. Ce pain lui paraissait une chose impossible, un objet fabriqué venu d’un endroit qui devait obéir à un ordre incroyablement rigide. (…) »
1922. Chargé d’une valise remplie de saucisses fumées – une spécialité de son père, miracle gustatif -, Fidelis débarque en Amérique, tel l’espoir. Ayant investi tout ce qu’il possédait dans ce billet vers New York, seul le contenu de cette valise peut lui permettre de poursuivre son voyage. Les saucisses s’avèrent excellentes et les acheteurs reviennent, plus nombreux, permettant ainsi à Fidelis de traverser Minneapolis, le Dakota du Nord et d’arriver à Argus, petite bourgade dénuée de reliefs. Très vite, il trouve du travail dans une boucherie et loue ses services aux alentours, notamment pour abattre les bêtes. Fort du secret de son père, il se lance avec succès dans la confection des saucisses fumées. La clientèle augmente, tandis qu’il économise le moindre centime pour payer le voyage jusqu’à Argus à son épouse et son fils, qui le rejoindront au printemps – bouffées d’amour sur le quai d’une gare.
Autre ville, autre vie. La plume de Louise Erdrich dessine rapidement un autre univers et pénètre le lecteur dans la sphère embuée de Delphine, orpheline de sa mère peu après sa naissance, élevée par un père alcoolique, comédienne sans théâtre ni troupe et – accessoirement – partenaire d’un équilibriste homosexuel pour lequel elle nourrit quelques sentiments.
« Les chaises tenaient toujours en équilibre au-dessus d’eux. Ils se regardaient dans les yeux, ce que Delphine commença par trouver fascinant. Mais que voit-on réellement dans les yeux d’un homme en appui renversé, avec six chaises en équilibre sur ses pieds ? On voit qu’il craint de les laisser tomber. »
1934, année de misère. Oublier ses malheurs n’a cependant pas de prix, et le duo Delphine-Cyprien amasse une jolie somme d’argent, fruit de leurs spectacles. Toutefois, en dépit de leur succès, Delphine souhaite rentrer dans sa ville natale – Argus - pour y retrouver son père Roy.
« Il y avait des stations-service, les pompes à essence fixées devant de petites boutiques branlantes, ici et là une touffe de maisons, un peuplier foudroyé. Et toujours l’accueillante monotonie, le ciel patient, sans pluie, et gris comme une toile goudronnée. »
Le paysage défile, Delphine et Cyprian roulent vers le sud. Leur voiture s’engage à l’entrée du village, où se situe la boucherie Waldvogel – Delphine rencontre alors Eva. Une rencontre visuelle, charmante, à l’insu d’Eva qui court joyeusement aux côtés de son fils. La voiture progresse dans le village, s’arrête devant une petite ferme délabrée où Roy accueille sa fille – tout en larmes et en alcool. S’ensuit un nettoyage gargantuesque de la demeure souillée, encrassée et moisie, menant à la découverte de cadavres en putréfaction dans la cave.
« En entrant dans la cuisine d’Eva, quelque chose de profond arriva à Delphine. Elle ressentit une fabuleuse expansion de son être. Prise de vertige, elle eut l’impression d’une chute en vrille et puis d’un silence, à la façon d’un oiseau qui se pose. »
Si le retour de Delphine fut marqué par cette trouvaille macabre, il fut également l’occasion de retrouvailles et de joies toutes humaines. Sa première rencontre spirituelle avec Eva reste cependant l’élément essentiel – et décisif - de son installation à Argus. Souhaitant acheter du lard, Delphine se rend à la boucherie Waldvoguel et engage ainsi la conversation avec Eva, qui sert pendant que son mari est à l’ouvrage. Rien d’original au travers de cet échange, mais une grande gentillesse se dégage d’Eva – qui invite naturellement Delphine dans sa cuisine, lui offre café et petit pain à la cannelle, aux raisins, sucre & beurre et lui transmet l’une de ses recettes.
« La rencontre avec Eva l’avait plongé dans un état rêveur – c’était presque comme d’être amoureuse mais en même temps très différent. Qu’Eva l’ait remarquée, et même emmenée à la cuisine, qu’Eva ait donné toutes les preuves qu’elle voulait la connaître, c’était là un plaisir bien trop inattendu. »
Cette rencontre ordinaire entre une commerçante et une cliente, cette rencontre courante et presque insignifiante pour le lecteur, possède un caractère exceptionnel pour Delphine. La force, le caractère puissant d’Eva l’attire – et plus d’une fois je me suis questionnée sur les sentiments réels de Delphine envers son amie. L’opportunité de travailler à la boucherie se présente à Delphine, une chance dont elle rêvait- elle accepte avec enthousiasme. Les tâches se succèdent alors, nombreuses tout comme les clients, dont une tante revêche et une excentrique qui mettent à l’épreuve Delphine.
« Elle roulait si vite que les gouttes lui piquaient le côté du visage tels de petits plombs. La violence des gouttes la tenait éveillée. Elle savait que de temps à autre, dans son dos, Eva émettait des sons. Peut-être la morphine, tout en calmant sa douleur, relâchait-elle son contrôle sur elle-même, car dans le crépitement humide du vent Delphine entendit un gémissement aigu et glacé qui pouvait émaner d’Eva. Un hurlement semblable à un crissement de pneus. Un grondement donnant à penser que sa douleur était un animal qu’elle terrassait. »
Le printemps, l’été. Une vague de chaleur s’abat sur Argus et terrasse ses habitants. Delphine et Eva s’active dans les locaux de la boucherie pour garder la viande fraîche, chaque minute devient un combat douloureux contre le soleil de plomb.
Eva s’évanouit – simplement, discrètement. Une tumeur pèse sur ses organes vitaux, il faut l’opérer d’urgence. Pendant des jours, des semaines, durant un laps de temps infini Delphine prend soin d’Eva – condamnée malgré les multiples traitements subis - et de ses fils, s’acquitte des tâches ménagères et fait fonctionner la boucherie. Durant des mois, Delphine aide Eva à mourir.
Le quotidien s’installe ensuite. Chargé de soucis – les enfants, le vide qu’a laissé Eva derrière elle, la boucherie, les clients, Roy et Cyprian – mais paisible, et parfois heureux. Le temps s’écoule alors que les pages se tournent, la plume de Louise Erdrich nous porte à travers les années et les enfants grandissent, tout comme leurs mésaventures – les adultes vieillissent, également. La seconde guerre mondiale se fait pressentir. Les garçons – devenus des jeunes hommes – s’engagent avec fierté, sous le regard douloureux de leur père. La famille – unie jusqu’alors – se fragmente, sous le poids des idées et des convictions. Les Waldvoguel connaissent alors d’autres chagrins, d’autres épreuves. L’auteure possède cependant l’immense qualité de savoir bouleverser la vie des personnages en collant à la réalité ; et tout comme le ciel n’est jamais tout à fait dégagé ni tout à fait sombre, le destin de Delphine et de sa famille vogue de bonheurs en déceptions, de découvertes en chagrins.
Magnifiquement humain, le roman ébranle les forces et les faiblesses des êtres. Les souffrances, tourments, satisfactions, joies, plaisirs et déplaisirs s’élèvent dans les airs, portés par le chant de Fidelis. Les voix des hommes s’élèvent alors, écho de cette puissance, cantilène des anges.
« Markus respirait à peine. Fit signe à Schatzie de s’asseoir derrière lui. Dissimulé dans l’ombre, sur le seuil, juste à la lisière du puits de paisible et rayonnante clarté, il jeta un coup d’œil dans la pièce et fut apaisé par ce qu’il vit. Il y avait son père, qui était à genoux auprès du lit de sa mère et lui tenait un pied. Ce pied était mince, d’un blanc de cire, et brillait presque dans la lumière fraîche de la lampe. Fidelis appuyait son front à l’endroit où le pied, en une courbe, rejoignait la cheville. Le dos de son père s’agitait, et après un moment de stupéfaction, Markus comprit que son père pleurait d’une façon atroce et silencieuse, une façon d’autant plus effrayante qu’elle était dénuée de sanglots et de larmes. Il n’avait encore jamais, vraiment jamais, vu son père pleurer. Le plus bouleversant c’était que le mouvement des épaules de son père ressemblait tant aux mouvements d’un rire convulsif. Puis Markus pensa que c’était peut-être un rire. Peut-être que sa mère, qui savait se montrer très drôle, venait de raconter une blague à son père. Mais le visage de celle-ci était calme. Markus l’entendait respirer, car ses respirations étaient de profonds et bruyants soupirs. Il observa un peu plus longtemps, mais alors Fidelis releva la tête et parut le regarder dans le blanc des yeux. Un frisson de peur parcourut Markus. Il s’immobilisa. Mais son père fixait sans le voir le mur peuplé d’ombres et ne l’aperçut pas.
Son père, toujours à genoux, se redressa avec lenteur puis borda tendrement la couverture autour des pieds d’Eva. Quand ce fut fait, Markus voulut s’en aller, de peur d’être découvert, mais il était toujours incapable de bouger. Les yeux de sa mère s’étaient ouverts et elle plongeait son regard dans les yeux de Fidelis, puis elle lui sourit. C’était un sourire magnifique, serein et plein de joie, un tressaillement de douceur sur son visage, que Markus n’oublierait jamais. Fidelis s’assit sur la chaise coincée à côté du lit étroit, et prit la main d’Eva. Sans qu’elle le lui demande, il se mit à lui chanter sa chanson préférée, une chanson que Markus connaissait, celle des sirènes dans la rivière en Allemagne. La voix de Fidelis était chaude et pure. Markus ferma les yeux. La voix de son père lui évoqua un goût de caramel brun et moelleux. Avec la chanson de son père pour le couvrir, Markus fila dans sa chambre. »
Ma note :
4,5/5
Mon avis :
La Chorale des maîtres bouchers est le roman d’une rencontre. Une rencontre aux visages multiples, infidèle et aussi légère que le vent, semblable à la chance, tant elle voltige – acrobate virtuose – d’un personnage à un autre.
« Fidelis rentra chez lui à pied en douze jours de la Grande Guerre, et dormir trente-huit heures dès qu’il se fut glissé dans son lit d’enfant. Quand il s’éveilla en Allemagne, fin novembre 1918, il n’était qu’à quelques centimètres de devenir français sur la carte redessinée par Clémenceau et Wilson, un fait sans importance au regard de ce que l’on pourrait manger. »
Les premières pages du roman plonge le lecteur au cœur de l’après-guerre, au côté de Fidelis, jeune soldat allemand et rescapé du fléau 14-18. Deux pages tournées, et déjà il rencontre Eva. Fiancée de son meilleur ami et victime involontaire de la Grande Guerre, Eva devient – en quelques mots prononcés - une jeune veuve au regard douloureux. Grandeur de l’amitié, amour de son prochain : un mariage succède rapidement à leur rencontre, Fidelis épousant à la fois la femme et l’enfant qu’elle porte.
« Il acquit la conviction qu’il devrait partir en Amérique parce qu’il vit, de ce pays-là, une tranche de pain. […] Cet homme tenait à la main quelque chose de blanc et de carré, que Fidelis prit d’abord pour une sorte d’image, mais elle était vierge. Quand il comprit que c’était du pain, modelé avec une précision qui ne pouvait être que l’œuvre de fanatiques, il se joignit au cercle des hommes pour l’examiner. […] Quand, passé de main en main, il parvint jusqu’à lui, Fidelis inspecta le pain. Il en nota la fine texture et s’interrogea sur le traitement de la levure, observa le bord bien taillé de la coupe, hocha la tête devant le brun doré étrangement uniforme de la croûte. Ce pain lui paraissait une chose impossible, un objet fabriqué venu d’un endroit qui devait obéir à un ordre incroyablement rigide. (…) »
1922. Chargé d’une valise remplie de saucisses fumées – une spécialité de son père, miracle gustatif -, Fidelis débarque en Amérique, tel l’espoir. Ayant investi tout ce qu’il possédait dans ce billet vers New York, seul le contenu de cette valise peut lui permettre de poursuivre son voyage. Les saucisses s’avèrent excellentes et les acheteurs reviennent, plus nombreux, permettant ainsi à Fidelis de traverser Minneapolis, le Dakota du Nord et d’arriver à Argus, petite bourgade dénuée de reliefs. Très vite, il trouve du travail dans une boucherie et loue ses services aux alentours, notamment pour abattre les bêtes. Fort du secret de son père, il se lance avec succès dans la confection des saucisses fumées. La clientèle augmente, tandis qu’il économise le moindre centime pour payer le voyage jusqu’à Argus à son épouse et son fils, qui le rejoindront au printemps – bouffées d’amour sur le quai d’une gare.
Autre ville, autre vie. La plume de Louise Erdrich dessine rapidement un autre univers et pénètre le lecteur dans la sphère embuée de Delphine, orpheline de sa mère peu après sa naissance, élevée par un père alcoolique, comédienne sans théâtre ni troupe et – accessoirement – partenaire d’un équilibriste homosexuel pour lequel elle nourrit quelques sentiments.
« Les chaises tenaient toujours en équilibre au-dessus d’eux. Ils se regardaient dans les yeux, ce que Delphine commença par trouver fascinant. Mais que voit-on réellement dans les yeux d’un homme en appui renversé, avec six chaises en équilibre sur ses pieds ? On voit qu’il craint de les laisser tomber. »
1934, année de misère. Oublier ses malheurs n’a cependant pas de prix, et le duo Delphine-Cyprien amasse une jolie somme d’argent, fruit de leurs spectacles. Toutefois, en dépit de leur succès, Delphine souhaite rentrer dans sa ville natale – Argus - pour y retrouver son père Roy.
« Il y avait des stations-service, les pompes à essence fixées devant de petites boutiques branlantes, ici et là une touffe de maisons, un peuplier foudroyé. Et toujours l’accueillante monotonie, le ciel patient, sans pluie, et gris comme une toile goudronnée. »
Le paysage défile, Delphine et Cyprian roulent vers le sud. Leur voiture s’engage à l’entrée du village, où se situe la boucherie Waldvogel – Delphine rencontre alors Eva. Une rencontre visuelle, charmante, à l’insu d’Eva qui court joyeusement aux côtés de son fils. La voiture progresse dans le village, s’arrête devant une petite ferme délabrée où Roy accueille sa fille – tout en larmes et en alcool. S’ensuit un nettoyage gargantuesque de la demeure souillée, encrassée et moisie, menant à la découverte de cadavres en putréfaction dans la cave.
« En entrant dans la cuisine d’Eva, quelque chose de profond arriva à Delphine. Elle ressentit une fabuleuse expansion de son être. Prise de vertige, elle eut l’impression d’une chute en vrille et puis d’un silence, à la façon d’un oiseau qui se pose. »
Si le retour de Delphine fut marqué par cette trouvaille macabre, il fut également l’occasion de retrouvailles et de joies toutes humaines. Sa première rencontre spirituelle avec Eva reste cependant l’élément essentiel – et décisif - de son installation à Argus. Souhaitant acheter du lard, Delphine se rend à la boucherie Waldvoguel et engage ainsi la conversation avec Eva, qui sert pendant que son mari est à l’ouvrage. Rien d’original au travers de cet échange, mais une grande gentillesse se dégage d’Eva – qui invite naturellement Delphine dans sa cuisine, lui offre café et petit pain à la cannelle, aux raisins, sucre & beurre et lui transmet l’une de ses recettes.
« La rencontre avec Eva l’avait plongé dans un état rêveur – c’était presque comme d’être amoureuse mais en même temps très différent. Qu’Eva l’ait remarquée, et même emmenée à la cuisine, qu’Eva ait donné toutes les preuves qu’elle voulait la connaître, c’était là un plaisir bien trop inattendu. »
Cette rencontre ordinaire entre une commerçante et une cliente, cette rencontre courante et presque insignifiante pour le lecteur, possède un caractère exceptionnel pour Delphine. La force, le caractère puissant d’Eva l’attire – et plus d’une fois je me suis questionnée sur les sentiments réels de Delphine envers son amie. L’opportunité de travailler à la boucherie se présente à Delphine, une chance dont elle rêvait- elle accepte avec enthousiasme. Les tâches se succèdent alors, nombreuses tout comme les clients, dont une tante revêche et une excentrique qui mettent à l’épreuve Delphine.
« Elle roulait si vite que les gouttes lui piquaient le côté du visage tels de petits plombs. La violence des gouttes la tenait éveillée. Elle savait que de temps à autre, dans son dos, Eva émettait des sons. Peut-être la morphine, tout en calmant sa douleur, relâchait-elle son contrôle sur elle-même, car dans le crépitement humide du vent Delphine entendit un gémissement aigu et glacé qui pouvait émaner d’Eva. Un hurlement semblable à un crissement de pneus. Un grondement donnant à penser que sa douleur était un animal qu’elle terrassait. »
Le printemps, l’été. Une vague de chaleur s’abat sur Argus et terrasse ses habitants. Delphine et Eva s’active dans les locaux de la boucherie pour garder la viande fraîche, chaque minute devient un combat douloureux contre le soleil de plomb.
Eva s’évanouit – simplement, discrètement. Une tumeur pèse sur ses organes vitaux, il faut l’opérer d’urgence. Pendant des jours, des semaines, durant un laps de temps infini Delphine prend soin d’Eva – condamnée malgré les multiples traitements subis - et de ses fils, s’acquitte des tâches ménagères et fait fonctionner la boucherie. Durant des mois, Delphine aide Eva à mourir.
Le quotidien s’installe ensuite. Chargé de soucis – les enfants, le vide qu’a laissé Eva derrière elle, la boucherie, les clients, Roy et Cyprian – mais paisible, et parfois heureux. Le temps s’écoule alors que les pages se tournent, la plume de Louise Erdrich nous porte à travers les années et les enfants grandissent, tout comme leurs mésaventures – les adultes vieillissent, également. La seconde guerre mondiale se fait pressentir. Les garçons – devenus des jeunes hommes – s’engagent avec fierté, sous le regard douloureux de leur père. La famille – unie jusqu’alors – se fragmente, sous le poids des idées et des convictions. Les Waldvoguel connaissent alors d’autres chagrins, d’autres épreuves. L’auteure possède cependant l’immense qualité de savoir bouleverser la vie des personnages en collant à la réalité ; et tout comme le ciel n’est jamais tout à fait dégagé ni tout à fait sombre, le destin de Delphine et de sa famille vogue de bonheurs en déceptions, de découvertes en chagrins.
Magnifiquement humain, le roman ébranle les forces et les faiblesses des êtres. Les souffrances, tourments, satisfactions, joies, plaisirs et déplaisirs s’élèvent dans les airs, portés par le chant de Fidelis. Les voix des hommes s’élèvent alors, écho de cette puissance, cantilène des anges.
« Markus respirait à peine. Fit signe à Schatzie de s’asseoir derrière lui. Dissimulé dans l’ombre, sur le seuil, juste à la lisière du puits de paisible et rayonnante clarté, il jeta un coup d’œil dans la pièce et fut apaisé par ce qu’il vit. Il y avait son père, qui était à genoux auprès du lit de sa mère et lui tenait un pied. Ce pied était mince, d’un blanc de cire, et brillait presque dans la lumière fraîche de la lampe. Fidelis appuyait son front à l’endroit où le pied, en une courbe, rejoignait la cheville. Le dos de son père s’agitait, et après un moment de stupéfaction, Markus comprit que son père pleurait d’une façon atroce et silencieuse, une façon d’autant plus effrayante qu’elle était dénuée de sanglots et de larmes. Il n’avait encore jamais, vraiment jamais, vu son père pleurer. Le plus bouleversant c’était que le mouvement des épaules de son père ressemblait tant aux mouvements d’un rire convulsif. Puis Markus pensa que c’était peut-être un rire. Peut-être que sa mère, qui savait se montrer très drôle, venait de raconter une blague à son père. Mais le visage de celle-ci était calme. Markus l’entendait respirer, car ses respirations étaient de profonds et bruyants soupirs. Il observa un peu plus longtemps, mais alors Fidelis releva la tête et parut le regarder dans le blanc des yeux. Un frisson de peur parcourut Markus. Il s’immobilisa. Mais son père fixait sans le voir le mur peuplé d’ombres et ne l’aperçut pas.
Son père, toujours à genoux, se redressa avec lenteur puis borda tendrement la couverture autour des pieds d’Eva. Quand ce fut fait, Markus voulut s’en aller, de peur d’être découvert, mais il était toujours incapable de bouger. Les yeux de sa mère s’étaient ouverts et elle plongeait son regard dans les yeux de Fidelis, puis elle lui sourit. C’était un sourire magnifique, serein et plein de joie, un tressaillement de douceur sur son visage, que Markus n’oublierait jamais. Fidelis s’assit sur la chaise coincée à côté du lit étroit, et prit la main d’Eva. Sans qu’elle le lui demande, il se mit à lui chanter sa chanson préférée, une chanson que Markus connaissait, celle des sirènes dans la rivière en Allemagne. La voix de Fidelis était chaude et pure. Markus ferma les yeux. La voix de son père lui évoqua un goût de caramel brun et moelleux. Avec la chanson de son père pour le couvrir, Markus fila dans sa chambre. »
Ma note :
4,5/5
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum



 Emploi/Loisirs
Emploi/Loisirs